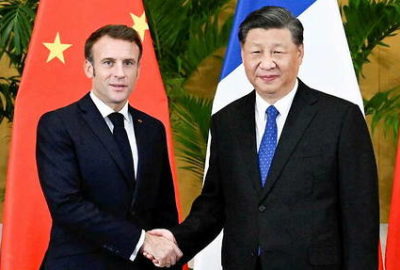Mali : Le Mali sous tutelle de la “communauté internationale”: une impasse! (4ème et dernière partie)
 Depuis trois ans, le Mali est sous tutelle de la “communauté internationale”. Est-il parvenu à reconstruire un Etat capable d’assumer ses fonctions régaliennes et la gestion d’une administration efficace ? S’est-il au contraire engagé dans des voies qui le conduiront inéluctablement à disparaître ? Telles sont les questions à aborder, si l’on ne veut pas voir la crise s’approfondir et se durcir.
Depuis trois ans, le Mali est sous tutelle de la “communauté internationale”. Est-il parvenu à reconstruire un Etat capable d’assumer ses fonctions régaliennes et la gestion d’une administration efficace ? S’est-il au contraire engagé dans des voies qui le conduiront inéluctablement à disparaître ? Telles sont les questions à aborder, si l’on ne veut pas voir la crise s’approfondir et se durcir.
L’auteur met en avant l’opinion par rapport au fonctionnement du système.
- C) Jusqu’où peut aller la déception de l’opinion ?
Trois enquêtes donnent une idée de la situation : deux d’entre elles emploient des méthodes quantitatives (Malimètre 7, EMOP), alors que la troisième, essentiellement participative, a pour intérêt de comparer ses observations à celles qui ont été faites en 2004.
Ce n’est pas sans inquiétude qu’on lit le diagnostic posé par Ousmane Kornio dans son rapport pour la Fondation Friedrich Ebert : “Ce que les trois régions (Tombouctou, Gao et Kidal) ont en commun, ce sont les activités de trafic de drogue menées avec une complicité généralisée, tant des leaders traditionnels locaux que des représentants des hautes sphères de l’Etat en passant par une série d’intermédiaires dont les élus locaux, les forces armées et de sécurité et les préfets.
” La lutte pour les profits tirés de ces activités est masquée par la mise en avant de conflits annexes (par exemple entre clans Touaregs dans la région de Kidal,) ou par le recours à des motivations plus présentables tant aux populations qu’on cherche à mobiliser qu’aux acteurs extérieurs qu’on voudrait voir intervenir : l’indépendance (thème du MNLA à Kidal), la religion (Ançardine à Tombouctou, avec ses complicités dans les milieux wahhabites locaux).
A Gao, ville éminemment cosmopolite, les narcotrafiquants ont exacerbé les conflits entre “peaux blanches” (Arabes et Touaregs) et les sédentaires à “peau noire” (Peuls, Songhaïs, Bellas…). Partout dans le Sud du pays la méfiance s’est installée, à l’égard des wahhabites à longue barbe et pantalon court, à l’égard des réfugiés du Nord, à l’égard des “peaux blanches”, parfois à l’égard des marabouts et de leurs talibés, lorsqu’ils se sont trop visiblement ralliés aux assaillants (par exemple dans la région de Mopti).
La situation est donc extrêmement instable. En même temps, la population s’est rendu compte de la totale impuissance de l’Etat. Il semblerait que neuf sur dix des hommes adultes des régions qui ont été occupées possèdent maintenant une ou plusieurs armes, et soient décidés à se faire justice. La multiplication des attaques de tous genres en est la conséquence.
L’EMOP confirme : à propos des “problèmes d’envergure qui perdurent, voire s’aggravent : menace terroriste, conflit armé, corruption endémique”, les citoyens réalisent de plus en plus que les autorités étatiques n’ont pas la capacité de les résoudre. “La démobilisation des citoyens qui se conjugue avec l’érosion de la confiance à l’égard de l’Etat et la hausse du sentiment d’insécurité sont autant de signaux inquiétants qui doivent être pris en compte pour éviter un basculement du pays dans l’instabilité”, pouvait-on écrire l’an dernier dans le compte-rendu de cette enquête. Aujourd’hui, comme le montrent la constitution de mouvements peuls armés qui prétendent devoir se défendre contre les sédentaires, l’instabilité est installée partout. Quelle institution peut rétablir la paix civile ?
“Trois institutions (le fisc, la justice et la police) suscitent non seulement la défiance, mais ceux qui y ont été confrontés sont encore plus critiques que les autres” signale l’EMOP. Il faut ajouter que les maires suscitent autant la défiance que le fisc.
Dans cette enquête, ni l’armée ni les autorités (le Président, les autorités religieuses) ne font l’objet de jugements défavorables. On peut évidemment penser que la population évite de les mettre en cause, et il y aurait à cela deux raisons évidentes : le caractère officiel de l’enquête peut susciter un réflexe de prudence à l’égard de l’autorité ; par ailleurs, la conception courante du pouvoir, fanga, la force, joue certainement son rôle. Pourtant, l’enquête révèle une évolution récente de l’opinion, lorsqu’on l’interroge sur la corruption : cette évolution est défavorable non seulement pour les autorités religieuses et leaders traditionnels, mais aussi pour le Président, les ministres, les députés, et encore pour les services d’éducation.
Le jugement sur la classe politique et les représentations aux trois niveaux (local, régional, national) est sévère : “la moitié des répondants (54%) considère qu’elles ne reflètent pas les préoccupations des citoyens. Pour un citoyen sur quatre, elles ne les relaient même pas du tout, et n’œuvrent que pour leur propre intérêt. Finalement, seuls 20% leur font crédit en affirmant qu’elles sont plutôt tournées vers la réalisation du bien commun, et moins de 2% sont convaincus qu’elles s’y consacrent à part entière.”
Les résultats de Mali-mètre7 sont plus inquiétants encore. La majorité des enquêté(e)s (58,4%) est peu satisfaite (25,0%) ou pas satisfaite (33,4%) des actes posés par le président de la République dans la gestion du pays ; de même, à propos des actions du gouvernement, deux tiers des enquêté(e)s (64%) ne sont pas satisfaits (38%) ou sont peu satisfaits (26%) de ses actions, contre moins d’un tiers (29%) se déclarant satisfait ou très satisfait. Et à propos de l’action des députés, les deux tiers des enquêté(e)s (66%) ne sont pas (43%) ou sont peu (23%) satisfaits. Il faut craindre que la situation d’insatisfaction ait encore empiré depuis un an.
Selon Mali-mètre7 encore, les deux tiers des sondés ne font pas ou peu confiance à la justice de leur pays, et les raisons qu’ils invoquent sont “la justice est corrompue” (80%) et “la justice est au service des riches” (67%) ou du pouvoir (30 %). Sont citées au premier rang des secteurs concernés par la corruption : la justice (63,7%), la police (56,7%), la douane (43,7%), la mairie (37,7%), la santé (33,3%) et la gendarmerie » (28,3%).
La région de Mopti se signale par la proportion la plus élevée de personnes répondant qu’elles ne font pas confiance en la justice (73,3 %) à quoi s’ajoute une proportion non négligeable (12,2 %) de répondants qui ne lui font qu’un peu confiance. Les motifs couramment invoqués dans les documents officiels lorsqu’ils s’agit de donner un rôle officiel aux cadis (la justice coûte trop cher, ou ses procédures sont longues, compliquées, méconnues de la population, elle est trop éloignée) ne sont évoqués que par des pourcentages infimes des répondants.
Le tableau que révèle Malimètre7 est donc beaucoup plus sombre que celui qui ressort des enquêtes de l’INSTAT.
Parallèlement réapparait à Bamako une pratique barbare qui s’était manifestée occasionnellement à la chute de Moussa Traore, le sinistre article 320. Le passé récent a d’ailleurs montré la forme que pourrait prendre l’expression d’une colère populaire : on se souvient des manifestations organisées par le MP22. Là n’est pourtant pas le moyen de régler les graves problèmes politiques de l’heure. Que signifie, quant à elle, la manifestation politique exceptionnelle qui s’est déroulée à Bamako, le 21 mai, regroupant plusieurs milliers de personnes à l’appel d’une large opposition ? Débouchera-t-elle sur un sursaut du pouvoir ? ou sur une organisation enfin efficace de l’opposition, alors que le statut officiel qui a été donné à son chef semble l’avoir anesthésié ?
Hélas, il faut bien l’admettre, contrairement à l’image qu’avait le Mali à l’extérieur, non seulement l’attachement à la démocratie est plus faible dans ce pays que dans les autres pays d’Afrique, mais encore que c’est précisément entre les années 2008 et 2012 -lorsque le régime ATT a montré de quoi il était capable- que l’attachement à la démocratie a chuté brutalement de dix points. Devant l’incapacité des élus à entreprendre les négociations politiques qui s’imposent pour sortir le pays de l’impasse, la situation n’a pu que se détériorer.
Conclusion
C’est un fait universel, désormais, qu’un Etat ne se limite plus à un territoire ; mais un Etat reste indissociable d’un pouvoir sur les hommes, par la règle de droit qu’il édicte et par le monopole de l’usage de la force qu’il exerce ; ces fonctions régaliennes sont exercées par une administration publique. Evidemment, tout contexte de crise justifie des modalités particulières qui peuvent exiger un assouplissement de ce schéma. Mais le Mali :
– N’a pas su réagir à l’infiltration de son administration par des partenaires au développement qui interviennent comme en pays conquis sur les sujets les plus délicats (Isaline Bergamaschi cite la privatisation de la CMDT, la réadmission des expulsés, le droit de la famille) et par des ONG qui géraient le pays avec l’administration ;
– A laissé s’installer des groupes hostiles et des narcotrafiquants dans ses zones septentrionales ;
– A été incapable de résister à l’envahissement de deux tiers de son territoire par ces groupes et leurs alliés extérieurs ;
– S’est montré complètement passif et dominé dans le processus d’Alger ;
– Se voit maintenant amené à satisfaire aux revendications des groupes armés avant d’avoir obtenu leur désarmement et leur cantonnement ;
– N’a jamais voulu analyser et nommer les causes profondes de la crise de 2012, et donc ne propose rien dans aucun des domaines d’où naissent des conflits locaux violents et où s’exprime l’insatisfaction profonde de la population : la justice, le foncier, l’emploi des jeunes, l’éducation…
C’est une parodie d’Etat qui s’est reconstruite en 2013, avec les élections souhaitées par la “communauté internationale”, avec un candidat présentant bien, capable de servir tous les régimes, et emmenant avec lui sa famille et les députés choisis par cette dernière et par le secrétaire général de son parti. La défense est assurée par la MINUSMA et par Barkhane, puisque la reconstitution d’une armée malienne est une tâche décennale, à peine commencée (quelques bataillons et une formation qui prête à discussion) ; la justice est tellement méprisée que les citoyens se vengent eux-mêmes des torts qu’ils ont subis (art. 320) et que les religieux et les cadis revendiquent un nouveau moyen d’étendre leur emprise sur la population ; l’économie est aux mains des “partenaires du développement” qui à nouveau rédigent eux-mêmes les projets de développement qu’ils vont financer ; la police est si corrompue et si décriée, l’impunité si parfaite, que l’insécurité règne sur tout le territoire…
Il n’y a pas de reconstruction de l’Etat parce qu’il n’y a pas de projet politique. Le mouvement de déliquescence de la pensée politique date d’un demi-siècle : les idées politiques des militants de l’indépendance ont été mise en œuvre dans la première décennie de l’indépendance, mais elles ont complètement disparu depuis et n’ont pas été remplacées. Certes, le panafricanisme a joué son rôle dans les années 1990, mais il était complété par une stratégie visant à répondre aux besoins élémentaires de la population ici et maintenant. Les espoirs nés de l’instauration de la démocratie et de la décentralisation ont fait long feu, car il leur fallait bien plus d’une décennie pour se concrétiser. Aujourd’hui, il est clair que les groupes armés n’ont pas plus de projet politique que le gouvernement : d’un côté comme de l’autre, on veut le pouvoir pour le pouvoir, rien d’autre.
Ce qui se passe sous nos yeux, ce n’est pas une reconstruction de l’Etat, parce que la “communauté internationale” refuse de voir que le problème politique doit être traité par des moyens politiques. Au contraire, elle se contente d’administrer le pays, de le protéger tant bien que mal des agressions extérieures dont il est victime –sans pour autant oser s’attaque au cœur du problème, au nerf de la guerre : à la drogue–, de secourir quelques populations ruinées par les combats, l’insécurité, l’obscurantisme, de veiller à ce que l’incendie ne se propage pas au voisinage. Elle exerce de fait, d’ores et déjà, un protectorat, sans le dire bien sûr, sur un Etat fantôme, vide de toute ambition et de toute compétence, qui ne dispose plus que des signes extérieurs de son rôle.
Quel est le dirigeant politique, quel est le parti qui proposera à l’opinion nationale et internationale un projet à hauteur des difficultés et des enjeux de l’heure ? Depuis des mois l’opposition demande l’organisation de concertations nationales, où l’on voit bien reparaitre le moyen qui a permis à plusieurs Etats africains de sortir des crises des années 1990. Cette formule, “mode de transition original, propre à l’Afrique”, suppose évidemment que soit reconnue la nécessité d’une transition vers une nouvelle organisation politique, vers un nouveau projet politique. N’est-il pas temps de reconnaître que c’est exactement ce dont le Mali a besoin ?
Car, si aucune initiative politique forte de ce genre n’est prise, il faut craindre qu’à nouveau un lieutenant ou un capitaine se sente appelé par l’ambition de jouer au chef d’Etat… Dans ce climat, le thème à la mode est celui de réconciliation. Mais on en parle trop pour que ce soit la réconciliation qu’on cherche effectivement : il pourrait plutôt d’agir de blanchir ceux qui ont poussé le pays jusqu’au précipice et tous ceux qui ont profité et profitent des avantages immédiats que leur apporte la décomposition de l’Etat.
Le reconstruction d’un Etat serait possible après une transition menée par les forces vives de la Nation. Elle exigerait que la vérité soit recherchée et dite, que la justice se prononce, que les torts soient reconnus et les sanctions acceptées. Alors on pourrait envisager de rebâtir un contrat social sur des bases saines, et reconstruire un Etat capable d’arbitrer les conflits d’intérêts, de défendre le pays contre ses agresseurs, de dire le droit et de le faire respecter, d’éduquer la jeunesse et de lui donner du travail, d’imposer la solidarité entre régions, entre générations, entre malades et bien portants.
Tout ce en quoi se complait la “communauté internationale” ne fait que durcir et approfondir la crise, à laquelle il faudra nécessairement trouver une solution politique.
JOSEPH BRUNET-JAILLY
Docteur ès sciences économiques en 1967, agrégé de l’enseignement supérieur en sciences économiques en 1970. Il est consultant indépendant, et est actuellement chargé d’enseignement à Sciences-Po.