Mali : la dérive autoritaire du régime des putschistes

Assimi Goïta, entouré des membres du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), sur le point de faire une conférence de presse où il s’autoproclame chef de la junte au pouvoir au Mali, après le coup d’État. (Photo: Kassim Traoré / VOA)
Les autorités maliennes ont annoncé mi-mars la suspension de RFI et France 24. Petit à petit, le pouvoir fait taire les voix critiques dans le pays, tandis que l’armée est accusée de nombreuses exactions, pour l’heure impunies, contre les civils.
Ce fut d’abord une revendication, qui pouvait alors sembler folle, d’un mystérieux Comité pour la défense des militaires (CDM) dont on ignore tout, jusqu’à l’identité de ses membres, et qui, depuis quelques mois, s’est érigé, via des communiqués incendiaires, en censeur de toute voix critique. C’est devenu une réalité le 16 mars, lorsque les autorités maliennes ont annoncé la suspension de Radio France internationale (RFI) et de France 24, et l’interdiction faite « à toutes les radios et télévisions nationales, ainsi qu’aux sites d’information et journaux maliens », de rediffuser les émissions des deux médias français.
Depuis lors, au Mali, on ne peut plus écouter RFI à la radio ni regarder France 24 à la télé – deux médias très suivis dans ce pays comme dans de nombreux autres de l’Afrique de l’Ouest. Le seul moyen d’avoir accès à leurs émissions est de disposer d’une connexion internet et d’utiliser un VPN.
Cette mesure radicale est intervenue après la publication, sur les ondes et le site de RFI, d’une enquête sur des allégations d’exactions commises par des soldats maliens dans le centre du pays. Une pratique – l’enquête – comparée par le gouvernement (issu du double coup d’État d’août 2020 et de mai 2021) à celles de la sinistre Radio des Mille Collines, qui avait joué un rôle majeur dans l’exécution du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.
Ce parallèle odieux illustre la dérive du régime militaro-civil dirigé par un quarteron de militaires, à la tête desquels se trouve le colonel Assimi Goïta, et par le premier ministre de la transition, Choguel Kokalla Maïga.
Voilà plusieurs semaines que les journalistes travaillant au Mali ont senti le vent tourner. Le 31 janvier, les correspondant·es de la presse dite « occidentale » (BBC, RFI, Jeune Afrique, AFP, Le Monde, entre autres) avaient été convoqué·es au ministère de la communication. Après ce coup de pression, la délivrance des accréditations avait été suspendue. Aujourd’hui, la plupart des journalistes étrangers (dont beaucoup sont français) installés à Bamako ne disposent plus de cette accréditation. Officiellement, ils ne peuvent donc plus exercer leur travail.
« On a fait la demande, mais on n’a pas encore eu de réponse, ni négative ni positive », explique l’un d’eux, sous couvert d’anonymat. « On fait avec, poursuit un autre. Certains ont choisi de signer leurs articles sous pseudo. D’autres continuent comme si de rien n’était, mais ils y réfléchissent à deux fois avant d’appeler une source officielle. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et on a tous en tête que personne n’est à l’abri d’une mauvaise surprise. Certains ont décidé de quitter le pays plus tôt que prévu. D’autres se demandent quand ils seront expulsés, comme Benjamin Roger. » Le 7 février, ce journaliste de Jeune Afrique qui venait d’atterrir à Bamako a été arrêté par la police et expulsé dans le premier vol pour Paris, au motif qu’il n’avait pas d’accréditation.
« Ce gouvernement, qui est déjà très isolé sur le plan diplomatique, veut s’isoler encore plus en imposant un huis clos total pour faire ce qu’il veut dans le pays. Pour cela, il lui faut se débarrasser des journalistes étrangers », déplore un responsable d’une ONG malienne qui, lui aussi – et comme toutes les personnes interrogées dans le cadre de cet article –, a requis l’anonymat.
« Les journalistes ont peur désormais. C’est nouveau au Mali. » Un défenseur des droits humains
Les journalistes étrangers ne sont pas les seuls à être ciblés par le pouvoir. Les journalistes maliens se disent également préoccupés. « Depuis quelque temps, certains d’entre nous ont reçu des intimidations, des coups de pression. Ce n’est jamais bien méchant. Ni trop direct. Et cela n’émane jamais d’une autorité officielle. Mais ce sont des amis, des sources ou des contacts qui nous glissent des mots : “Tu devrais faire attention”, “Ton article n’a pas plu”, explique un journaliste expérimenté de la presse écrite. Au sein des rédactions, on se pose plus de questions qu’avant dès lors que l’on traite de l’actualité politique ou sécuritaire. Il y a la peur des représailles, mais aussi de vraies tensions entre ceux qui, parmi nous, veulent continuer à faire leur travail correctement, et ceux qui pensent que l’on doit avant tout faire preuve de patriotisme et soutenir les autorités. »
De fait, aujourd’hui, la profession est divisée, et certains des journalistes les plus influents ont pris fait et cause pour la junte, qui dispose encore d’un large soutien à Bamako. Après la suspension de RFI et de France 24, Bandiougou Danté, président de la Maison de la presse, a publié un communiqué dans lequel il « prend acte » de cette décision et « invite tous les médias nationaux et étrangers à davantage de responsabilité et [à] œuvrer à soutenir les Forces armées et de sécurité dans le noble combat contre le terrorisme ». D’autres organisations de la presse ont soutenu le choix du gouvernement.
Si les rumeurs sur l’achat de conscience de journalistes vont bon train, c’est surtout la crainte de représailles qui semble dicter ce surprenant suivisme dans un pays jadis reconnu pour sa tolérance. Une figure de la société civile, très active dans la défense des droits humains, indique avoir enregistré, au niveau de son organisation, deux plaintes de journalistes qui disent avoir été victimes d’une tentative d’enlèvement. Il ne compte plus les témoignages d’intimidations.
Des vidéos issues de la propagande du régime, probablement conçues par des professionnels de l’intoxication, circulent sur les réseaux sociaux, s’en prenant nommément à des politiques ou des journalistes et relayant des rumeurs nauséabondes sur leur compte. « Tout cela aboutit à une forme d’autocensure, continue le défenseur des droits humains. Les journalistes ont peur désormais. C’est nouveau au Mali. »
Des personnalités politiques arrêtées
Mais la profession n’est pas la seule concernée. Les défenseurs des droits humains se trouvent dans la même situation. « Il y a une telle dérive que l’on a peur de prendre position publiquement. Individuellement, mais aussi collectivement. Nos organisations sont désormais paralysées », souligne un cadre d’une organisation de défense des droits humains qui est silencieuse depuis quelque temps, tant sur les atteintes à la liberté d’expression que sur les allégations d’exactions commises par les militaires dans le cadre de la lutte « antiterroriste ». Lui-même refuse de s’exprimer publiquement. « En interne, il y a des débats. Certains pensent qu’on doit mettre les critiques en sourdine pour soutenir ce gouvernement et gagner la guerre contre les djihadistes. Les autres ne sont pas d’accord, mais ils ont peur. Ce régime a montré qu’il ne reculait devant rien. »
Cet activiste fait notamment référence aux récentes arrestations de personnalités politiques qui ont marqué les esprits. Deux d’entre elles semblaient intouchables avant leur incarcération. Il y eut tout d’abord Issa Kaou N’Djim, un des porte-parole du Mouvement du 5-Juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP), une coalition de partis politiques et d’organisations de la société civile qui a été en pointe en 2020 dans la contestation visant le président Ibrahim Boubacar Keïta.

Assimi Goïta, coauteur de deux coups d’état en neuf mois, a été investi président de la transition. Lors de sa prestation de serment, le 7 juin, à Bamako.
Après le coup d’État du 18 août 2020, N’Djim est devenu un ardent défenseur des putschistes, puis il a été nommé quatrième vice-président du Conseil national de la transition, organe législatif de la transition en grande partie contrôlé par l’exécutif. Ce poste lui assurait théoriquement une certaine immunité. Pourtant, le 26 octobre 2021, il a été interpellé pour « troubles à l’ordre public » et « propos subversifs » après avoir critiqué le premier ministre. Libéré deux semaines plus tard, le 9 novembre, il a été condamné à six mois de prison avec sursis le 3 décembre pour « atteinte au crédit de l’État et injures commises via les réseaux sociaux ». Depuis, il se fait discret.
Puis il y eut Oumar Mariko. Le président du parti d’extrême gauche Sadi (Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance) est une figure de l’opposition depuis 30 ans. Il a une belle cote de popularité au sein de l’armée (il avait d’ailleurs soutenu le coup d’État de 2012) et jouit d’un certain respect dans la classe politique, en dépit de ses positions tranchées. Pourtant, le 6 décembre, il a été placé en garde à vue, puis incarcéré durant plus d’un mois, pour avoir tenu des « propos injurieux » à l’égard du premier ministre : il l’avait traité de « menteur » dans une conversation privée dont l’enregistrement avait fuité sur les réseaux sociaux.
Décès en prison d’un ancien premier ministre
Un autre cas a envoyé un message très clair à la communauté des chercheurs et chercheuses. Le 16 janvier, l’économiste Étienne Fakaba Sissoko a été placé en détention préventive pour des « propos tendant à la stigmatisation ou à la discrimination régionaliste, ethnique ou religieuse ». La veille, il expliquait sur TV5 Monde que les conséquences économiques liées aux sanctions de la Cédéao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest) pourraient être dramatiques pour le Mali. Après deux mois sous les verrous, Sissoko a obtenu une liberté provisoire le 22 mars.
Depuis son arrestation, la plupart des chercheurs qui portaient un regard critique sur le régime se font discrets. « Pourquoi irais-je dire ce que je pense, si c’est pour finir en prison ?, explique l’un d’eux, qui était un habitué des plateaux télévisés et des tribunes dans la presse écrite auparavant. Quand on voit ce qui est arrivé à SBM [Soumeylou Boubèye Maïga – ndlr]… »
Ministre du gouvernement d’Amadou Toumani Touré et premier ministre d’Ibrahim Boubacar Keïta, SBM avait été incarcéré en août 2021 dans le cadre d’une enquête judiciaire liée à une affaire de corruption. Durant sa détention, sa santé s’est rapidement détériorée. En dépit des demandes répétées de sa famille et du corps médical, le pouvoir a refusé de le laisser sortir pour se faire soigner à l’étranger. Il est mort le 21 mars dans une clinique de Bamako. La fermeté du régime malien a suscité l’indignation dans la sous-région. Le président nigérien, Mohamed Bazoum, qui était un ami de Maïga, a été (comme souvent) le plus direct : « Je pensais que de tels assassinats relevaient d’une autre ère », a-t-il tweeté.
L’armée accusée de torture
La dérive autoritaire du régime inquiète jusqu’à l’ONU. Un cadre onusien en poste à Bamako, qui a lui aussi requis l’anonymat en raison du calendrier (un rapport sur la situation des droits humains au Mali doit bientôt être présenté à la presse), admet que le régime malien prend de plus en plus « les formes d’une dictature ». « C’est très préoccupant, souligne-t-il, car il semble n’avoir aucune limite. Et, surtout, il l’assume totalement, ce qui montre qu’il n’a rien à faire des critiques de la communauté internationale. »
C’était précisément la principale crainte des défenseurs des droits humains lorsque la Cédéao a annoncé une série de sanctions très dures à l’égard du Mali le 9 janvier dernier. « Si le régime est isolé, il va durcir le ton. Les militaires auront carte blanche pour réprimer toute opinion critique », prédisait alors un juriste. Il craignait également une dérive dans le cadre de la lutte « antiterroriste ». Il avait vu juste.
Car la répression ne se cantonne pas à Bamako et aux voix critiques. Depuis quelques mois, les Forces armées maliennes (FAMA), accompagnées de paramilitaires russes présentés par plusieurs sources occidentales comme des éléments de la société de sécurité privée Wagner, ont entrepris de reconquérir les territoires abandonnés aux djihadistes.
Pour ce faire, les militaires semblent n’avoir aucune limite. Les allégations d’exactions contre des civils dans le centre du Mali se sont multipliées ces dernières semaines. Elles ont notamment été relayées par RFI (ce qui lui a valu sa suspension) et par Le Monde, qui a rapporté des cas de tortures. Et elles ont été documentées par Human Rights Watch : dans un rapport publié le 15 mars, l’ONG accuse l’armée d’avoir tué au moins 71 civils dans le centre du Mali.
Plusieurs sources au sein de la Minusma (la mission des Nations unies au Mali) confirment à Mediapart que le rythme des exactions s’est accéléré depuis le début de l’année. Arrestations, exécutions, découvertes de corps sans vie, cas de tortures : les alertes sont de plus en plus nombreuses. Et si aucune enquête n’a pour l’heure été bouclée, des éléments recueillis par le département des droits de l’homme de la mission sont accablants pour l’armée.
Début mars, 35 corps sans vie, brûlés et entassés les uns sur les autres, ont été découverts aux abords du hameau de Danguéré Wotoro, dans la commune de Dogofry. Plusieurs témoins affirment que les victimes avaient été arrêtées quelques jours plus tôt par les FAMA, accompagnées de « Blancs ». Mais pour le gouvernement, il s’agit de « fausses allégations sans aucun fondement ». D’ailleurs, en dépit de l’effroi provoqué par un film montrant les corps calcinés et qui circule sur les réseaux sociaux, aucune enquête judiciaire n’a été ouverte sur cette affaire.
























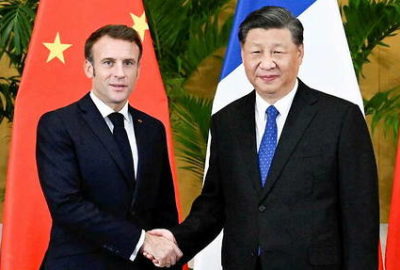














Pingback: Mali : la dérive autoritaire du régime des putschistes – Malicom – L’info sur le bout des doigts. | Malicom – Actualité du Mali sur Internet